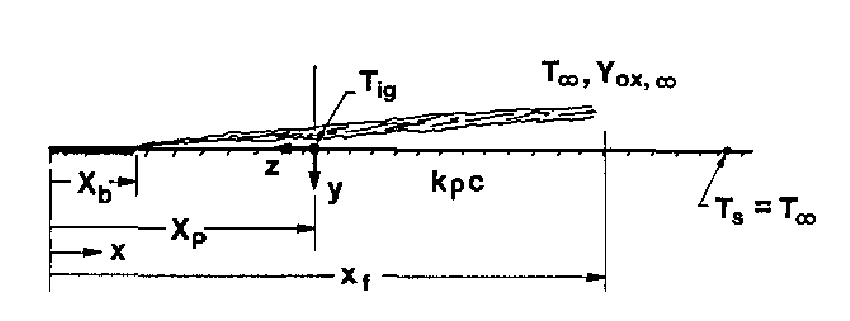Article initialement publié dans Fascismo / Antifascismo (Lazo Ediciones, 2024). Ce livre comprend Cuando mueren las insurrecciones (Quand meurent les insurrections) et Fascisme / Antifascisme de Gilles Dauvé, les débats qu’il a suscités avec la revue Aufheben [en anglais] et un extrait d’un entretien avec Troploin. Relayé par la suite par le groupe Cuadernos de Negacion en 2024 et traduit de l’espagnol au français par Les Amis de la Guerre de Classe. Au-delà d’un ton parfois polémique, ce texte rappelle des faits historiques intéressants pour penser les limites de l’antifascisme.
Depuis plus de dix ans, nous avions l’intention de publier une critique concise de l’antifascisme compilant divers articles, dont beaucoup n’ont pas été inclus dans ce livre, mais que nous avons fait circuler dans d’autres médias. Dès le début du siècle, nous avons largement diffusé un texte qui nous venait d’Espagne et qui s’intitulait « L’antifascisme comme forme d’adhésion au système ». À l’époque, nous voulions provoquer et débattre avec des punks et des skinheads, ainsi qu’avec des anarchistes qui adhéraient au nouvel antifascisme en tant que mouvement de contre-culture et phénomène de gangs. Nous voulions souligner que le fascisme et l’antifascisme étaient bien plus que des combats de rue et des affrontements entre bandes rivales. Qu’ils n’étaient pas simplement des formes de lutte, mais principalement des contenus politiques qui, dans leurs expressions traditionnelles et contemporaines – même en tenant compte de leurs grandes différences – n’avaient et n’ont rien à voir avec le dépassement du capitalisme, bien au contraire. Nous nous référons à la politique dans son sens le plus simple : « Art, doctrine ou opinion concernant le gouvernement des États ».
Aujourd’hui, alors que les médias parlent d’« Antifa », que Trump est allé jusqu’à l’accuser, il y a quelques années, de déstabiliser les États-Unis, cette intention du début du millénaire semble lointaine, mais son objet n’a pas disparu ; au contraire, il fait partie d’une question plus large. En Argentine, un mouvement diffus qui n’exclut pas l’électoralisme, et même souvent s’en inspire, commence à populariser les notions d’antifascisme moderne. Lorsqu’un candidat qui n’est pas du goût de la social-démocratie ou du péronisme dit de gauche ou progressiste gagne, on parle de fascisme, de dictature. C’est ainsi que Macri et Milei ont été qualifiés de fascistes. Ainsi, un « antifascisme électoral » apparaît comme synonyme d’anti-droite, et il est devenu interchangeable de parler de « la montée du fascisme », « de la droite », ou « du libéralisme ». C’est l’appel à l’unité pour défendre le capitalisme et sa démocratie, typique de l’antifascisme historique.
De leur côté, les résidus du fascisme classique réapparaissent comme une alternative politique pour les prolétaires insatisfaits : invocations de ses versions originales par quelques nostalgiques, provocateurs ou ignorants, et fondamentalement ses variantes néo ou postfascistes. Les nouvelles droites, de plus en plus ancrées dans la population active, présentent différentes tendances critiques de la société capitaliste, de certains de ses excès et fondamentalement en réponse aux politiques libérales-progressistes des dernières décennies et au soi-disant « mondialisme ». Malgré leur belligérance plus ou moins grande, toutes les grandes variantes de la droite en Occident se présentent aux élections. Elles vont même jusqu’à se présenter comme antipolitiques pour sauver la politique au nom du contraire. 2024, préviennent-ils, est une année charnière à cet égard, avec la popularité croissante des alternatives de droite dans de nombreux pays et de nouvelles qui apparaissent. Le fait qu’elles aient toutes formé des partis politiques et se présentent aux élections de manière ordonnée en dit long. La voie électorale et l’ordre démocratique sont respectés à gauche comme à droite.
Dans le « meilleur » des cas, les luttes menées par l’antifascisme renforcent l’illusion largement répandue selon laquelle l’État est un arbitre au-dessus des classes, ce qui s’accompagne souvent d’une conception du capital non pas comme un rapport social, mais comme une poignée de multinationales ou d’hommes cruels et cupides. Et dans le « pire » des cas, cela conduit à l’unité antifasciste. Hier et aujourd’hui pour des élections ordonnées, pour maintenir la normalité capitaliste. Hier et aujourd’hui pour faire la guerre ou accepter des « états d’exception » au nom de la démocratie.
Bien sûr, il est parfois nécessaire d’affronter les néo-nazis dans un quartier ou une ville pour des raisons de survie immédiate. Mais cela ne conduit pas nécessairement à une idéologie antifasciste ou antiraciste, de même que lutter pour de meilleures conditions de travail ne nous oblige pas à former un syndicat ou à défendre la prétendue dignité du travail.
Les bandes fascistes peuvent devenir un danger effroyable et peuvent même bénéficier du soutien voilé des gouvernants, de la police, des journalistes et des patrons. Ceux-là mêmes qui les abandonneront à leur sort lorsqu’ils ne leur seront plus d’aucune utilité. Ce dont la bourgeoisie ne peut se débarrasser, c’est de ses forces de sécurité pour maintenir la paix capitaliste, celles qui torturent et tuent au quotidien, les mêmes qui, paradoxalement ou non, appliquent les lois contre l’antisémitisme, tout comme elles répriment les manifestations contre la dégradation des conditions de vie. Ils se conforment docilement à tout ce que la loi de la bourgeoisie commande en fonction du contexte.
Ce qui est aujourd’hui défini internationalement comme Antifa est un mouvement activiste décentralisé comprenant un certain nombre de groupes autonomes. Ils peuvent ou non recourir à la violence ou à la réforme politique, ou même s’opposer à l’État, mais ils veulent forcer l’État à renoncer à sa nécessaire composante réactionnaire et/ou libérale de droite. À son tour, l’antifascisme d’aujourd’hui s’est transformé en expressions politiques plus larges, liées aux mouvements sociaux et à la politique progressiste qui entre dans sa phase la plus impuissante dans un contexte de stagnation économique, parallèlement à la croissance de la nouvelle droite.
L’antifascisme et le fascisme sont nés dans certaines conditions spécifiques du développement du capital, qui ont aujourd’hui considérablement changé. L’antifascisme électoral d’aujourd’hui et l’antifascisme de rue qui affronte les gangs néonazis, très répandus aux États-Unis et en Europe, ne sont pas l’antifascisme étatique et militaire des années 1930 et 1940, qui libérait les villes en tuant et en violant leurs habitants. Mais ils en sont bien les héritiers politiques, et c’est pourquoi il est important de le souligner à la lumière de l’histoire.
Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont soumis les prolétaires de tous les pays à un nouvel ordre mondial : un régime capitaliste démocratique à l’Ouest (avec ses répressions et ses dictatures chaque fois que nécessaire) et un régime « capitaliste d’État » dans le bloc soviétique. Ils ont ainsi imposé la résignation, sous prétexte qu’ils avaient conquis la liberté, ou du moins évité un totalitarisme de droite, et que la situation aurait été pire si les autres avaient gagné. C’est la campagne de peur constante choisie par les antifascistes.
L’alliance impérialiste qui a gagné la guerre mondiale, incarnée par Staline, Roosevelt et Churchill, est celle qui insiste sur l’importance du fascisme. C’est l’histoire officielle des « bons » qui explique qui sont les « méchants ». Il suffit de voir lequel des deux camps d’assassins, d’exploiteurs et de violeurs a été banni et lequel ne l’a pas été. C’est ce bannissement qui fait croire à beaucoup qu’en choisissant le camp proscrit, on s’oppose au statu quo. C’est peut-être ce qui explique que, parfois, la « rébellion tourne à droite ».
Les néo-nazis ou les bandes racistes et anti-immigrés sont un problème de rue dans de nombreuses villes, mais, comme hier, cela n’oblige pas à devenir « antifa ». Cette même étiquette, aujourd’hui comme hier, sert à unir opprimés et oppresseurs, exploiteurs et exploités, gouvernants et gouvernés. Au nom de l’antifascisme, nous sommes appelés à nous unir à nos exploiteurs, nous sommes appelés à défendre les assassins d’aujourd’hui : les gouvernants progressistes ou gauchistes de n’importe quel pays, qui ont eux aussi du sang sur les mains. Ou à s’unir aux héritiers d’autres meurtres de masse, comme les staliniens ou les maoïstes, qui combattent le mouvement communiste au nom du « communisme ».
Il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire non plus qu’ils aient les mains tachées de sang, même si on peut se demander quel dirigeant, par ses actes ou par omission, ne les a pas… Il ne s’agit pas simplement de lutter contre les excès de la démocratie, mais contre la démocratie en tant qu’ordre de l’exploitation organisée, de la société de classes.
Mais comment se fait-il que nous parlions encore de fascisme ? Si l’on parle encore de fascisme aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à l’idéologie antifasciste. Et il ne s’agit pas simplement d’une question de sémantique, d’une erreur de dénomination. Il vaut mieux appeler un chat un chat. Trump, Bolsonaro ou Milei sont peut-être beaucoup de choses, mais ils ne sont pas fascistes, tout comme le FMI ou la BM. Il se trouve que les appeler par ce nom est très utile pour créer un front politique très large où tout le monde trouve sa place, mais où seuls quelques-uns sont aux commandes.
La stratégie antifasciste est toujours la même. Si Twitter ou Facebook censure l’ancien président américain, ce n’est que justice ; s’il censure ses opposants, c’est une atteinte aux droits. Si ceux que l’on qualifie de fascistes ont violé ou torturé, cela doit être dénoncé, mais si les pays qui ont vaincu les nazis ont fait de même, cela est passé sous silence. De même qu’aujourd’hui encore, on ne parle pas des viols massifs (douze millions !) dont les femmes ont été victimes dans les pays vaincus lors de la deuxième guerre et même dans des pays alliés libérés comme la France.
Dans ces contrées, et au moins pour l’instant, rassembler une série d’ennemis sous l’étiquette de fascistes, ce n’est plus pour nous envoyer à la guerre, mais pour présenter la démocratie libérale comme le seul horizon possible. Elle aura ses défauts, nous dit-on, mais elle vaut mieux que le fascisme.
Mais la guerre est toujours là, et aujourd’hui, « au cœur de l’Europe », elle a des leçons à nous donner sur cette question. Le 24 février 2022, Poutine a déclaré la guerre avec un euphémisme :
« J’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Elle aura pour but de défendre le peuple qui, depuis huit ans, subit les persécutions et le génocide du régime de Kiev. À cette fin, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine. »
Que la plupart des gauchistes soutiennent l’action de la Russie contre l’Ukraine, considérée comme un « nid de néo-nazis », n’est guère surprenant. Que Poutine soit lui-même un ultra-nationaliste autoritaire et conservateur, très proche du post-fascisme eurasien des actuels défenseurs de l’Empire russe, ne semble pas leur importer beaucoup, car plutôt que des anticapitalistes radicaux, ces gauchistes sont simplement des opposants à « l’impérialisme gringo ». Nombre d’entre eux n’ont jamais compris que le stalinisme était une contre-révolution et continuent de croire que la « Mère Russie » d’aujourd’hui est l’héritière légitime de l’Union soviétique des années les plus héroïques.
Mais aussi, lorsque les démocrates et les progressistes en général qualifient de « fascisme » tout un ensemble de politiques et d’identités (comme les soi-disant néo-nazis, l’alt-right, les théoriciens du complot, l’antiféminisme réactionnaire, les gangs anti-immigrés, l’anarcho-capitalisme dans toutes ses variantes, le national-bolchevisme, et toute nouvelle identité « de droite »), ils avouent ne pas comprendre ce qui se passe ou ne pas vouloir le comprendre.
Pour ceux qui sont en campagne électorale permanente, l’évocation de la « menace fasciste » n’est qu’un artifice discursif comme l’urgence d’une transition vers les énergies renouvelables, ou la promesse de mesures sécuritaires. « Tout dans l’État, rien hors de l’État, rien contre l’État », disait Mussolini. Mais avec le bon dosage, sans excès ni extrémisme.
Cette tentative désespérée de faire revivre le fantôme du fascisme n’a pas pour but de susciter un soutien enthousiaste à la démocratie en Occident, comme ce fut le cas il y a 90 ans. Parce que ce n’est plus nécessaire, ils ont déjà gagné. Et ils ne disent pas « choisissez, c’est le meilleur » mais « c’est tout ce qu’il y a ». C’est pourquoi tout ce qui n’est pas prodémocratie pour le progressisme n’est que déchet et illusion, depuis les dérives réactionnaires pseudo-critiques de la démocratie jusqu’à la perspective communiste de l’émancipation humaine. Aujourd’hui, ce n’est pas la démocratie qui semble être en jeu, mais plutôt une alternance politique très discursive, dans un contexte géopolitique où les tensions entre blocs nationaux s’exacerbent. Si certains régimes, comme celui de la Russie, ne sont pas démocratiques au regard des critères occidentaux, ils ne constituent pas la norme. Et en matière de guerre, l’OTAN démocratique a été le principal guerrier du dernier demi-siècle.
Nous assistons à une surenchère du « risque totalitaire » dans le seul but de se disputer le commandement des États démocratiques, de part et d’autre du centre. On ne peut être sûr qu’une dérive plus généralisée vers des formes étatiques totalitaires ne soit pas possible, mais, en tout cas, il faut réaffirmer avec Dauvé que l’antifascisme n’a pas arrêté le fascisme, de même que la gauche plus ou moins progressiste n’a pas arrêté la droite plus ou moins réactionnaire. Il existe bien sûr des affrontements entre différentes fractions de la bourgeoisie, mais dans quelle mesure est-il possible d’influer sur cette dynamique d’opposition afin de défendre l’alternative la moins terrible ? Dans quelle mesure cette perspective nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle d’une transformation révolutionnaire ? Les antifascistes d’aujourd’hui se posent-ils cette question ? S’en préoccupent-ils ? Le capital exige une gestion différente de l’État en fonction des besoins liés à sa reproduction, y compris les contre-révolutions et les guerres. Il est important de comprendre d’où provient la nécessité de chaque transformation des régimes politiques avant de se rallier à l’un d’entre eux.
Gilles Dauvé rappelle que le fascisme historique n’était pas réellement opposé à la démocratie, mais constituait une exceptionnalité dans la défense du capital. La question n’était donc pas « fascisme ou démocratie », mais « fascisme et démocratie ». Lorsque l’on analyse les vestiges du fascisme dans ses nouvelles formes, deux dimensions sont considérées : la violence et l’idéologie. En ce qui concerne la première, les démocraties occidentales contemporaines – avec des gouvernements de gauche et de droite – répriment et utilisent des « états d’exception » lorsque c’est nécessaire, sans se tourner vers des formes d’État ouvertement totalitaires. La démocratie inclut et perfectionne la répression « fasciste » ainsi que la guerre ouverte au nom de sa défense. Pour leur part, les expressions d’extrême droite ont exercé leur mandat démocratiquement et avec beaucoup de retenue, malgré leurs discours de combat idéologique extrémiste. Hitler et Mussolini sont arrivés au pouvoir par des voies semi-institutionnelles avec leurs partis-milices, puis ont pris le contrôle total de l’État et ont lancé le grand effort de guerre. Rien de tel n’est en train de se produire. Pour l’instant, la démocratie n’alterne pas avec les « nouveaux fascismes » ou les états d’exception, mais les a intégrés.
« Depuis 1945, ce n’est pas un renouveau de la Gauche Communiste, ou la mise en ligne d’Amadeo Bordiga sur Internet, qui menace l’antifascisme : c’est de l’intérieur qu’il se vide de sens. Avec la fin du nazisme, rien ne va plus de soi. Un mal n’est absolu que s’il reste unique : or, le « fascisme » ne cesse de se reproduire en une succession de figures opposées, chacune de moins en moins crédible comme incarnation exclusive du Mal. Le fasciste actuel, est-ce Bush le belliciste, ou son ennemi l’antisémite Ahmadinedjad ? Le dilemme antifasciste n’est pas la pénurie d’ennemis mais leur surabondance. […] L’extrême-droite implantée au nord de l’Europe n’est justement que cela : l’extrême de la droite, non un mouvement né d’une violence populaire pour restaurer par la dictature l’autorité de l’Etat. Le prétendu péril fasciste s’avère soluble dans la démocratie. »
[Karl Nesic & Gilles Dauvé, Au-delà de la démocratie, L’Harmattan, Paris, 2009]
La critique de l’antifascisme telle qu’elle a été déployée pendant près de cent ans par la gauche communiste italienne et poursuivie par diverses expressions anticapitalistes n’est pas un programme tactique et stratégique à répéter, mais c’est une bonne leçon à ne pas oublier dans notre situation actuelle.
Le frontisme antifasciste a été, comme le fascisme, le résultat et l’expression de la défaite de l’assaut révolutionnaire des quatre années 1917-21. Son essence réside dans le renoncement substantiel à la lutte révolutionnaire contre le capitalisme (qui, dans le meilleur des cas, a été reportée à des temps meilleurs), au nom de la restauration de la démocratie et de l’« État de droit ». Son horizon est l’interclassisme, c’est-à-dire l’alliance entre classes ou fractions de classes, sur la base d’une opposition commune au fascisme, ce qui impose en premier lieu le renoncement aux méthodes de lutte spécifiquement prolétariennes.
Nous sommes aujourd’hui à des années-lumière d’un contexte social un tant soit peu comparable, en termes d’intensité de la lutte des classes, à celui des années 1920-1930.
Prétendre qu’un « danger fasciste » plane aujourd’hui sur nos têtes n’est ni plus ni moins qu’une idiotie. Il n’y a pas de dictature fasciste à nos portes : la seule dictature existante – aujourd’hui comme hier – c’est celle du capital, de la valeur en procès, qui envahit et domine désormais tous les recoins de la vie et des relations sociales.
« Ce qui vaut pour l’antifascisme vaut pour tous les « anti-ismes » : la transformation de l’ennemi en ennemi absolu se nourrit du mythe et le reproduit. […] Le « fascisme » devient ainsi une catégorie passagère, la clé qui permet d’« expliquer » et de faire tenir ensemble les phénomènes les plus disparates : de la répression policière normale et démocratique aux manifestations de racisme dans les banlieues et les quartiers prolétaires ; des politiques anti-immigration des gouvernements de toutes couleurs et de tous bords au retour sur scène d’une foule néo-fasciste aussi agressive et médiatique (grâce aussi aux « antifascistes ») que numériquement modeste ; des nouvelles étapes du processus de vidage progressif des fonctions des parlements nationaux – transversal à tous les États occidentaux depuis au moins 1914 – aux violences de genre ; en passant par le succès croissant des partis et mouvements « souverainistes » et/ou « populistes », culminant en Italie en 2018 avec la formation du gouvernement Lega-M5S. Et aux États-Unis avec l’élection de Trump. Tout, dans la petite tête de l’antifasciste plus ou moins militant, s’assemble pour composer la représentation déformée d’une société et d’un État de plus en plus « fascisés ». Comme si les phénomènes susmentionnés étaient incompatibles avec la démocratie (de droite et de gauche) tant vantée ! Et comme s’ils ne trouvaient pas leur nécessaire base matérielle dans les rapports sociaux capitalistes et leur évolution historique. »
[F.B., Miseria del antifascismo, 2018].
La critique de l’antifascisme n’est donc pas une question de cohérence logique, encore moins le maintien d’un purisme doctrinaire. Elle a émergé et s’approfondit à partir des luttes et pour les luttes.
Lutter contre ceux qui gouvernent aujourd’hui en les qualifiant de fascistes ne fait que réclamer davantage de démocratie, et n’a fait que placer au gouvernement les progressistes qui les remplacent pour que les « fascistes » puissent revenir par la suite. Les exemples en Argentine sont clairs et au Chili ils nous éblouissent. Bachelet et Boric ont mis en œuvre des lois que la droite n’aurait pas pu imposer. Dans les mains de Piñera, des lois qui absoudraient les carabiniers meurtriers ou leur permettraient de tirer sans avertissement seraient fascistes, dans les mains des « socialistes », c’est de l’ordre.
Avec cette série d’affirmations et de démentis, nous souhaitons contribuer aux luttes en cours. Et nous voulons surmonter le traumatisme. Un traumatisme si grand qu’aujourd’hui, alors que nous sommes les témoins directs de l’un des plus terribles massacres de cette civilisation, celui perpétré par l’État d’Israël à Gaza, certains s’obstinent à ne pas appeler les choses par leur nom, qualifiant Israël de fasciste, comme s’il ne suffisait pas de savoir qu’il s’agit d’un État capitaliste, phare de la démocratie et du marché au Moyen-Orient, exportateur d’engins de mort dans le monde entier. Il semble moins sérieux de les appeler démocrates et capitalistes, ou de les appeler simplement meurtriers.
 La façade du Café des sports au Lion-d’Angers (Maine-et-Loire) est maculée de peinture rouge et l’inscription « raciste » y a été taguée. Les gendarmes ont constaté les dégradations vers 8 h, ce vendredi 15 août 2025. Le Café des sports avait déjà été la cible d’une action du même type en décembre 2024. Plusieurs plaintes ont été déposées.
La façade du Café des sports au Lion-d’Angers (Maine-et-Loire) est maculée de peinture rouge et l’inscription « raciste » y a été taguée. Les gendarmes ont constaté les dégradations vers 8 h, ce vendredi 15 août 2025. Le Café des sports avait déjà été la cible d’une action du même type en décembre 2024. Plusieurs plaintes ont été déposées.